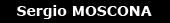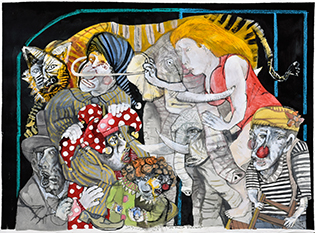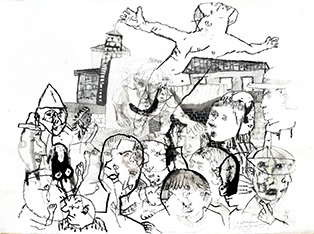OEUVRES
BIOGRAPHIE
VIDEOS
Retrouvez les oeuvres de Sergio Moscona sur ArtSper |
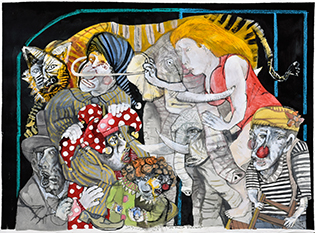
Sergio Moscona" Le cirque", 2018,
acrylique sur toile 150 x 210 cm
|

Sergio Moscona" Le cirque", 2018,
acrylique sur toile 150 x 210 cm
|

Sergio Moscona" Le cirque", 2018,
acrylique sur toile 150 x 210 cm
|

Sergio Moscona" Le cirque", 2018,
acrylique sur toile 150 x 210 cm
|

Sergio Moscona" Le cirque", 2018,
acrylique sur toile 150 x 210 cm
|

Sergio Moscona" Le cirque", 2018,
acrylique sur toile 150 x 210 cm
|

Sergio Moscona Le cirque 2018
Acrylique sur papier |

Sergio Moscona Le cirque 2018
Acrylique sur papier |

Sergio Moscona Le cirque 2018
Acrylique sur papier |

"
El Salvador IV ", 2018,
58 x 76 cm |

"
El Salvador ", 2018,
56 x 76 cm |
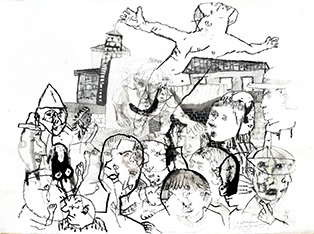
"
El Salvador V ", 2018,
56 x 76 cm
|
« Mon œuvre se
nourrit de faits sociaux, c’est un jeu constant avec ce
qui arrive, une interaction qui déplace et retourne les
choses avec la seule intention de tenter de s’en
approcher à partir d’un point où je puisse, dans la
mesure du possible, les comprendre ».
Né
en 1979, Sergio Moscona vit et travaille à Buenos Aires,
Argentine.
« A
34 ans, ce prodige argentin apparait comme une des
figures montantes de l’art contemporain mondial. Nourri
au génie de Picasso, il tisse une épopée humaine,
brutale et raffinée, tragicomique et monumentale »
tiré de l’article Inhumaine comédie écrit
par Marion
KLING dans Artension n° 120, 2013.
« Les
femmes de la place de Mai, photos d’enfants brandies
comme des armes, les défilés
de militaires en grand uniforme, les violences dans les
rues, sont autant d’images de la dictature en Argentine
(1976-1983), que Sergio Moscona n’a eu de cesse de
montrer dans sa peinture.
Né en 1979, Moscona vit à Buenos Aires. Issu de la
classe moyenne (sa mère est psychanalyste et son père,
médecin), il dit n’avoir pas souffert directement du
régime politique de son pays. Son travail semble
cependant marqué par ces années et le contexte social et
politique demeure toujours présent dans ses toiles. Son
oeuvre s’inscrit ainsi dans une tradition narrative dans
laquelle on peut voir l’héritage d’une lignée d’artistes
argentins, politiquement engagés, tels Antonio Segui (né
en 1934), ou Antonio Berni (1905-1981). Les peintres de
la « Otra Figuracion » des années 1960, qui se
distinguent par le traitement très libre de la figure
humaine, l’influenceront aussi durablement. Le motif de
Sergio Moscona, c’est l’homme, qu’il représente surtout
en groupe, mêlé à des foules et à des processions.
Cependant,
là où les masses, telles que le totalitarisme les a
forgées, abolissent l’individu, la foule, telle que
Moscona la montre, non seulement n’attente pas à
l’individu mais le préserve, le rehausse au-dessus de sa
condition d’homme seul. A l’évidence, ces corps
étroitement mêlés dans des étreintes violentes ou
fraternelles reflètent chez l’artiste l’obsession de
l’improbable réconciliation entre les êtres. Les formes
compressées et sans arrière-plan qui débordent presque
de la surface, expriment cette hantise. C’est dans les
rues grouillant de monde et dans les bus de Buenos Aires
que Moscona glane ses images. Pour en restituer les
sons, le mouvement, les parfums, il les superpose sur la
toile ou le papier, en couches transparentes et leur
fait subir des décalages. Par le biais de différents
plans juxtaposés ou enchevêtrés, il laisse apparaître
les personnages les uns à travers les autres, faisant
surgir des espaces temps inattendus (un peu comme les
repentirs, ces images incertaines, peintes sur les
toiles anciennes que l’on découvre à la faveur d’une
radiographie). L’ensemble est riche de la multiplication
des solutions plastiques proposées et surprend par sa
diversité. A seulement 36 ans, Moscona a déjà réalisé
des dizaines de séries, déclinées sur toutes sortes de
supports, certaines comme l’« Interprétation libre de
Guernica » de Picasso ayant donné lieu à d’innombrables
peintures et dessins à l’encre de Chine, au crayon et à
l’acrylique.
Car
l’exemple proche c’est évidemment Picasso, dont la
référence est plus qu’assumée. Extrêmement maîtrisées,
ses séries de dessins à l’encre de Chine semblent
obtenues d’un seul trait, comme se plaisait à le faire
le maître espagnol. Les lignes peuvent se montrer
précises, fourmillantes de griffures et de détails ou
réduites à l’essentiel et à la limite de l’abstraction
(« Hommage
à Guernica »,
2006). Mais la virtuosité du dessin de Moscona puise
aussi sa source dans l’observation de l’œuvre de Lajos
Szalay, artiste hongrois installé en Argentine dans les
années 1950. Moscona étudie de manière approfondie son
dessin et son admiration s’exprime à travers sa propre
production, à la filiation revendiquée.
La prédominance du trait se retrouve dans les oeuvres
peintes. Cloisonnées à l’intérieur de lignes fines
tracées au crayon, les teintes subtiles de l’acrylique
traitée comme de l’aquarelle ; rose, orangé, mauve
ou vert tendre, adoucissent la puissance expressive du
dessin, tandis que dans d’autres toiles, l’acrylique est
utilisé en aplats de couleurs franches, serties d’épais
contours qui évoquent la composition des vitraux.
Il
en résulte une oeuvre que l’on peut qualifier de «
figurale »1 et d’expressionniste, le type de personnages
de Sergio Moscona, constituant un des aspects les plus
caractéristiques de son travail. Hommes, femmes, enfants
peuvent paraître grotesques : les têtes semblent trop
volumineuses pour les corps, les nez tordus, les regards
chassieux. Tantôt les visages expriment la béatitude,
tantôt ils ressemblent à des masques mortuaires. Ces «
gueules » balafrées de grands à-coups qui rappellent les
sociétés primitives, ces bouches ouvertes sur l’os des
dents, à la manière de Bacon, ce sont à la fois des
types et des individus, non dénués d’un certain
prestige.
Mais
il y a aussi quelque chose de religieux dans l’oeuvre de
Moscona. Tant du point de vue de la tradition formelle -
les séries « Problèmes
primaires sans pitié »
(2009), par exemple, ne sont pas sans parenté avec des
crucifixions et des descentes de croix – que du contenu.
A cet égard, « Les
fleurs brisées »,
sa dernière et nouvelle série présentée ici, semble
évoquer la douleur d’hommes dans l’attente d’une
absolution qui leur est refusée. Les animaux domestiques
souvent présents chez Moscona, passent au second plan.
La fleur que tendent les personnages est le fil
conducteur de la série. Ces fleurs sont fanées, brisées,
à l’image des rêves que poursuivent les hommes. Mais ne
traduisent-elles pas aussi leur espoir d’être pardonnés
? Et les images de Moscona ne demandent-elles pas
réparation pour des crimes qui ont laissé des traces
indélébiles ? En reprenant à son compte des techniques
et des questions fondamentales qui ont traversé
l’histoire de l’Art, Sergio Moscona montre une oeuvre
débordante d’humanité, tournée vers les autres. Si
certains artistes ont abandonné la peinture, Moscona,
lui, peint plus que jamais. Avec frénésie. Avec une joie
animale.
Marie-Josée
LINOU
Conservatrice en chef du patrimoine
Directrice des musées de Riom communauté
(Extrait
du texte consacré à S. Moscona -
Catalogue-Musée
Mandet – Exposition personnelle de novembre 2015 à
mars 2016)
« Il
n’est pas besoin de faire preuve de beaucoup de sagacité
pour dire que les tableaux de Moscona sont toujours
habités. Mais qu’est-ce qui occupe ces espaces ?
Qui vit sur ces terres ? Voilà qui est moins
évident. Pour ma part, je suggère : pas tout à fait
des hommes, pas tout à fait des bêtes, pas tout à fait
des choses ; ni un, ni plusieurs ; plutôt un
enchevêtrement de lignes (de forces) assumant les
diverses configurations d’où surgissent ses figures.
Ainsi, chaque personnage est un peu homme, un peu bête,
un peu chose ; à la fois un et plusieurs. Masque
passager, pli instable et momentané, improbable et
confus d’une multiplicité de traits en tension. Jamais
de point de départ sans équivoque, jamais une identité
cartésienne, claire et distincte. Jamais un individu
cuirassé dans ses certitudes.
Ainsi ses œuvres inquiètent. En elles s’accomplit de
façon portègne (1),
la prophétie nietzschéenne : avec Dieu, c’est
l’Homme qui meurt. Sergio Moscona dépeint les monstres
que nous sommes : nœuds opaques d’instincts,
pulsions, représentations et organes, pensées perverses
et affects misérables. Je vois dans la figure du monstre
l’un des fils conducteurs qui relie ses différents
travaux.
Et pourtant dans ses œuvres l’humain n’en finit pas de
dépérir. Comment résiste-t-il à son imminente
dissolution ? Non plus comme raison pure fièrement
auto-revendiquée, mais en tant que caresse. Les
bas-fonds sinistres et confus reflètent ça et là une
certaine tendresse. Dans leur dérive, ces êtres se
soutiennent mutuellement. Ils « sont à
plusieurs ». Et cela, non pas malgré leur
monstruosité, mais précisément en vertu de cette
insuffisance, de cette difformité, de cette porosité, de
cette instabilité propre aux monstres qu’ils
sont ».
Manuel MAUER
La
Tour abolie d’un météore
« Avec
ce sens du tragique qui a si souvent illuminé l’âme
hispanique, et notamment celle du Siècle d’or – du roman
picaresque avec le Lazarillo
de Tormes ou
de La
vie est un
songe de
Calderón de la Barca –, Sergio Moscona surgit dans le
monde de l’art d’aujourd’hui en flamboyant météore qui
n’a pas fini de jeter ses lueurs, fussent-elles parfois
crépusculaires, ironiques ou sardoniques. La trentaine,
le jeune peintre argentin pourrait, à l’image de
Sigismond, le héros du dramaturge, déclarer : « La
vie, c’est ce
songe que je fais à présent. »
L’homme, on ne peut en douter, le fascine ; cet
infiniment petit plongé au sein de l’infinitude, Moscona
n’en finit pas, au prix d’une insolente authenticité,
sans complaisance, se refusant au jeu de la séduction,
de frayer un chemin dans la multitude et le fracas, le
dépouillement et les mutilations – corps et âmes –,
d’aborder des êtres imbriqués qui s’étreignent, se
disputent un espace où ils semblent inexorablement
confinés ; des hommes saisis dans leur désolante
incomplétude, aux visages graves, comme griffés,
sillonnés de traits, de sillons de vies superposées,
strates d’un passé révolu dont on ne peut guère espérer
la moindre grâce. Dans une série d’encres acryliques sur
papier intitulée Les
architectes de la parole, une singulière
élévation de corps enlacés, la Babel hautement
symbolique ne dit rien qui vaille, sinon l’aventure
dérisoire d’une humanité en quête de la parole perdue,
d’un amour irrémédiablement éperdu ; Babel aurait-elle
fini de hanter les hommes ? Selon l’astrophysicien
Stephen Hawking : « Il
n’est pasnécessaire d’invoquer Dieu…
L’Univers peut, et s’est créé lui-même
à partir de rien. La création spontanée est la
raison
pour laquelle il y a quelque chose plutôt que rien, la
raison pour laquelle l’Univers existe et nous
existons. »
Florent
FOUNÈS
(Extrait
d’un texte écrit à l’occasion
d’une
exposition consacrée à S. Moscona,
à la
Galerie Corcia, en 2011)
|